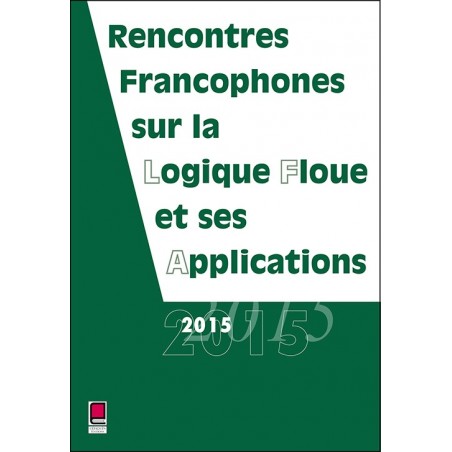
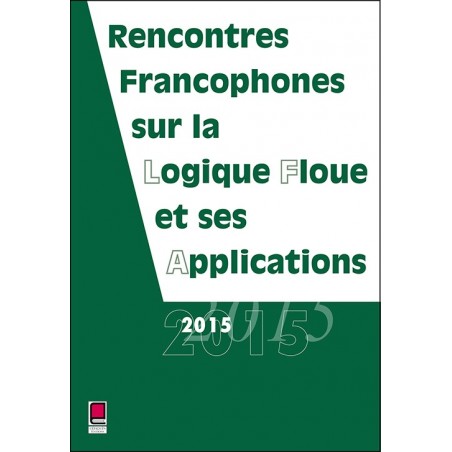
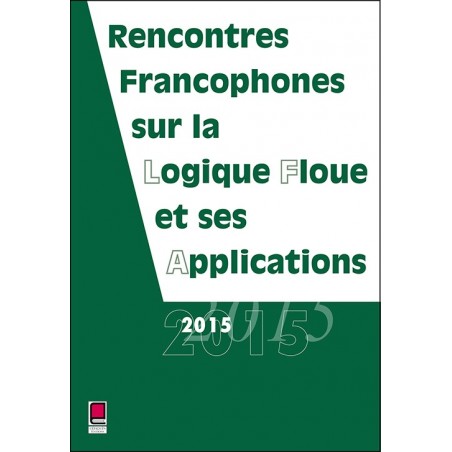

Commande avant 16h,
expédié le jour même (lu. - ve.)

Livraison express sous 48h.
La conférence LFA est la manifestation scientifique où les chercheurs viennent s'informer et débattre des avancées les plus récentes réalisées au sein de la communauté francophone, tant universitaire qu’industrielle, dans le domaine des théories de l'incertain. En particulier, LFA offre une bonne opportunité aux jeunes chercheurs du domaine de présenter leurs travaux à l’ensemble de la communauté francophone. LFA est aussi l’occasion de recueillir l’avis d’experts sur toute application impliquant la gestion et la quantification de l’incertain, la gestion des risques, ou la prise de décision en situation complexe.
Pour cette édition, qui se déroule à Poitiers, 35 communications, qui couvrent les différents domaines de la logique floue et de ses applications, ont été retenues. Ce programme est complété par 3 conférences invitées :
- la première, proposée par Didier Dubois et Henri Prade (tous deux Directeurs de Recherche au CNRS), retrace, à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'article inaugural "Fuzzy sets" de L.A Zadeh, ce que furent les débuts du flou en France une dizaine d'années plus tard.
- la seconde conférence est présentée par Anne-Laure Jousselme du CMRE de l'OTAN à la Spezia (Italie). Elle concerne l'étude de l'impact de la qualité de l'information sur la prise de décision au travers d'un jeu.
- la dernière, proposée par Michel Grabish (Professeur à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne), s'intitule "Les modèles GAI et les k-capacités en décision multicritère".
| Référence : | 1510 |
| Nombre de pages : | 318 |
| Format : | 17x24 |
| Reliure : | Broché |
| Rôle | |
|---|---|
| Collectif LFA | Auteur |
Un jeu pour étudier l’impact de la qualité de l’information sur la prise de décision
Anne-Laure Jousselme
Les débuts des ensembles flous en France il y a quarante ans
Didier Dubois, Henri Prade
Les modèles GAI et les k-capacités en décision multicritère
Michel Grabish
I Base de données et représentation
Explications linguistiques et graphiques de groupes de données
Grégory Smits, Olivier Pivert
Réparation efficace de requêtes floues
Olivier Pivert, Gregory Smits
Indices de confiance pour l’interrogation flexible de données imprécises
Ludovic Liétard
II Commande I
Observation des déséquilibres entre les cylindres d’un moteur à allumage commandé
Thomas Laurain, Jimmy Lauber, Reinaldo Palhares
Commande adaptative floue à modèle de référence des systèmes non linéaires avec contraintes sur l’entrée
Salim Labiod, Thierry-Marie Guerra
Synthèse de contrôleurs D-stabilisants pour les modèles flous T-S
Abdelmadjid Cherifi, Kevin Guelton, Laurent Arcese
III Théorie des Fonctions de croyance
Caractérisation d’experts dans les plate-formes de crowdsourcing
Amal Ben Rjad, Mouloud Kharoune, Zoltan Miklos, ArnaudMartin, Boutheina Ben Yaghlane
Utilisation des fonctions de croyance pour l’estimation du contenu informationnel des concepts d’une ontologie
Sébastien Harispe, Abdelhalk Imoussaten, François Trousset,Jacky Montmain
Fusion de préférences pour la détection de communautés dans les réseaux sociaux
Faten Elarbi, Tassadit Bouadi, Arnaud Martin, Boutheina Ben Yaghalane
Prédiction des liens dans les réseaux sociaux dans le cadre de la théorie des fonctions de croyance
Sabrine Mallek, Imen Boukhris, Zied Elouedi, Eric Lefevre
IV Préférence / Incertitude
Inconsistency-Based Ranking of Knowledge Bases
Said Jabbour, Badran Raddaoui, Lakdhar Sais
Axiomatisation de l’intégrale de Choquet possibiliste
Didier Dubois, Agnés Rico
Complétion analogique de préférences obéissant à une intégrale de Choquet
Marc Pirlot, Henri Prade
Multi-round Vote Elicitation for Manipulation under Candidate Uncertainty
Manel Ayadi, Nahla Ben Amor
V Applications Industrielles
Apprentissage automatique de règles floues et interprétabilité : application au classement d’événements sismiques
Laurence Cornez, Alberto Donizetti
Une architecture moderne de système expert flou pour le traitement des flux d’information
Jean-Philippe Poli, Laurence Boudet
Une nouvelle vision de l’évaluation et du guidage pour mieux situer et orienter l’apprenant dans un espace d’apprentissage
Abdelwahab Naji, Mohammed Ramdani
VI Logique - Logique Possibiliste
Agrégation des valeurs médianes et fonctions compatibles pour la comparaison
Bruno Teheux, Miguel Couceiro, Jean-Luc Marichal
La logique possibiliste avec poids symboliques : une preuve de complétude
Claudette Cayrol, Didier Dubois, Fayal Touazi
VII Décision Multicritères
Axiomatisation des intégrales de Sugeno k-maxitives
Miguel Couceiro, Quentin Brabant
Entre volonté et capacité : comment définir des objectifs atteignables
Diadé Sow, Abdelhak Imoussaten, Pierre Couturier, Jacky Montmain
Raffinement de la décision séquentielle possibiliste : de l’utilité qualitative optimiste à l’utilité espérée
Nahla Ben Amor, Zeineb Elkhalfi, Helene Fargier, Regis Sabbadin
VIII Commande II
Approche LMI pour la Commande Robuste H∞ et l’analyse de la stabilisation pour les modèles flous incertains de T-S à retard
Bourahala Faial, Khaber Farid
La logique floue et le filtrage de Kalman étendu pour la localisation de mobile du réseau sans fil
Mourad Oussalah, Naima Bouzera
Estimation de couple moteur et de couple embrayage basée sur un observateur flou discrétisé dans le domaine angulaire
Rémi Losero, Jimmy Lauber, Thierry-Marie Guerra
IX Incertitude et aspects temporels
Fuzzy-PDEVS : vers une méthode conceptuelle pour la gestion de conflits
Paul-Antoine Bisgambiglia, Romain Franceschini, Damien Foures, Eric Innocenti
Une approche crédibiliste pour la gestion de l’incertitude temporelle
Nessrine El Hadj Salem, Allel Hadjali, Boutheina Ben Yaghlane, Aymen Gammoudi
Vers des relations temporelles tolérantes
Aymen Gammoudi, Allel Hadjali, Boutheina Ben Yaghlane
X Logique Possibiliste étendue
Conditionnement en logique possibiliste à intervalles
Salem Benferhat, Amélie Levray, Karim Tabia
Pondération logique en logique possibiliste. Une discussion
Henri Prade
La logique possibiliste multi-agent : une introduction
Asma Belhadi, Didier Dubois, Faiza Khellaf-Hamed, Henri Prade
XI Motifs graduels dans les bases de données
Analyse des relations et des dynamiques de corpus de textes littéraires par extraction de motifs graduels
Amal Oudni, Mohamed Amine Boukhaled, Gauvain Bourgne
Extraction de motifs graduels émergents
Anne Laurent, Marie-Jeanne Lesot, Maria Rifqi
XII Image
Quelques liens entre la morphologie mathématique et l’analyse formelle de concepts
Jamal Atif, Isabelle Bloch, Céline Hudelot
Variante imprécise de la corrélation de rang de kendall appliquée au cas de données quantifiées
Hugo Saulnier, Ines Couso, Olivier Strauss
Livres de l'auteur Collectif LFA