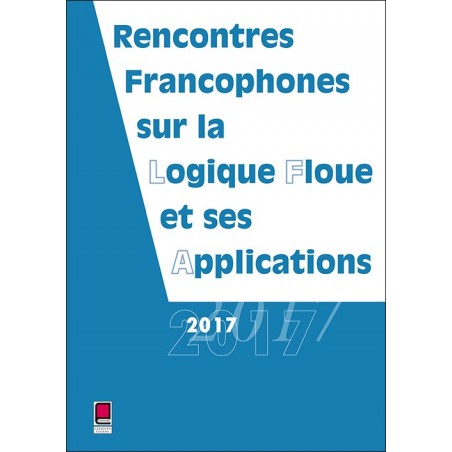



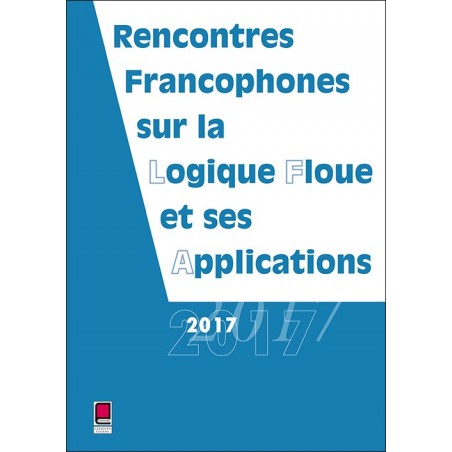

Les Rencontres Francophones sur la Logique Floue et ses Applications (LFA) constituent la manifestation scientifique annuelle où les chercheurs et industriels se réunissent afin de faire le point sur les développements récents des théories de l'imprécis et de l'incertain. Celles-ci comprennent par exemple les sous-ensembles flous, les possibilités, les fonctions de croyance, les probabilités imprécises, les ensembles approximatifs et aléatoires ou des logiques non classiques. Le large éventail de domaines couverts va de la commande floue, domaine historique de l'application des ensembles flous, à l'apprentissage automatique en passant par l'aide à la décision, le raisonnement, la fusion d'informations ou encore les bases de données, pour en citer quelques-uns.

Commande avant 16h,
expédié le jour même (lu. - ve.)

Livraison express sous 48h.
Les Rencontres Francophones sur la Logique Floue et ses Applications (LFA) constituent la manifestation scientifique annuelle où les chercheurs et industriels se réunissent afin de faire le point sur les développements récents des théories de l'imprécis et de l'incertain. Celles-ci comprennent par exemple les sous-ensembles flous, les possibilités, les fonctions de croyance, les probabilités imprécises, les ensembles approximatifs et aléatoires ou des logiques non classiques. Le large éventail de domaines couverts va de la commande floue, domaine historique de l'application des ensembles flous, à l'apprentissage automatique en passant par l'aide à la décision, le raisonnement, la fusion d'informations ou encore les bases de données, pour en citer quelques-uns.
Pour cette 26e édition, 28 articles, qui témoignent de cette diversité, à la fois des points de vue théorique et applicatif, ont été retenus. Ce programme est complété par 2 conférences invitées :
– l'une donnée par Susana Vieira, senior researcher au Center of Intelligent Systems, CIS – IDMEC-IST, à l'université technique de Lisbonne, sur les systèmes flous dans les applications médicales,
– l'autre donnée par Carl Frélicot, professeur à l'université de La Rochelle au laboratoire MIA (Mathématiques, Images et Applications), sur l'utilisation d'opérateurs d'agrégation et leur combinaison pour la définition de mesures de similarité.
| Référence : | 1614 |
| Nombre de pages : | 246 |
| Format : | 17x24 |
| Reliure : | Broché |
| Rôle | |
|---|---|
| Collectif LFA | Auteur |
CONFÉRENCES INVITÉES
– Fuzzy Systems in Health Care (Susana Vieira)
– Quelques travaux sur la similarité dans [0; 1] (Carl Frélicot)
FONCTIONS DE CROYANCE
– Le problème de tournées de véhicules avec des demandes évidentielles (Nathalie Helal, Frédéric Pichon, Daniel Porumbel, David Mercier, Eric Lefèvre)
– Un cadre évidentiel générique pour apprendre des préférences multi-critères (Sébastien Destercke)
– Raisons de croire, raisons de douter - Une relecture de quelques travaux en théorie des fonctions de croyance (Didier Dubois, Francis Faux, Henri Prade)
– Calibration évidentielle conjointe de classifieurs SVM binaires fondée sur la régression logistique (Pauline Minary, Frédéric Pichon, David Mercier, Eric Lefèvre, Benjamin Droit)
– La maintenance des bases de cas dans un cadre évidentiel (Safa Ben Ayed, Zied Elouedi, Eric Lefèvre)
BASES DE DONNÉES
– Vers un modèle OLAP flou basé sur les bases de données NoSQL orientées graphes (Arnaud Castelltort, Anne Laurent)
– Calcul, stockage et utilisation efficaces de résumés linguistiques de données massives (Grégory Smits, Olivier Pivert, Pierre Nerzic)
– Stockage de grands volumes de données géospatiales floues dans les bases de données NoSQL (Besma Khalfi, Cyril de Runz)
APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE
– Sélection d’attributs pour la classification d’objets 3D (François Meunier, Cyril de Runz, Christophe Marsala, Laurent Castanié)
– De la régression floue conventionnelle à la régression graduelle : analyse, réflexion et perspectives. Partie 1 : vision intervalliste (Reda Boukezzoula, Sylvie Galichet, Laurent Foulloy)
– De la régression floue conventionnelle à la régression graduelle : analyse, réflexion et perspectives. Partie 2 : vision graduelle (Reda Boukezzoula, Sylvie Galichet, Laurent Foulloy)
– Une méthode semi-supervisée pour la détection d’outliers basée sur les tables de décision ambiguës (Akram Hacini, Rabah Mazouzi, Herman Akdag)
– Vers la classification de matériaux à partir de compositions chimiques incertaines (Arnaud Grivet Sébert, Jean-Philippe Poli)
AGRÉGATION ET FUSION D’INFORMATIONS
– Sur les uninormes discrètes idempotentes (Miguel Couceiro, Jimmy Devillet, Jean-Luc Marichal)
– Utilisation des portes incertaines pour le calcul d’indicateurs pédagogiques (Guillaume Petiot)
– Sur l’efficacité des systèmes de formes normales de fonctions booléennes (Miguel Couceiro, Pierre Mercuriali, Romain Péchoux)
– Une approche possibiliste pour identifier les performances à améliorer dans le contexte incertain de la phase préliminaire de la conception (Diadie Sow, Abdelhak Imoussaten, Pierre Couturier, Jacky Montmain)
– Intégrales de Sugeno généralisées en analyse de données (Miguel Couceiro, Didier Dubois, Henri Prade, Agnès Rico)
COMMANDE
– Transformer les retards de transport variables en retards fixes : une application au problème du convoyeur (Thomas Laurain, Jimmy Lauber, Zsofia Lendek, Reinaldo Palhares)
– Régulation de la température lit d’un four d’incinération à lit fluidisé circulant : approche LMI (Souad Rabah, Hervé Coppier, Mohammed Chadli)
– Analyse du contrôle de la position assise par observateur à entrées inconnues via un modèle non-linéaire descripteur discret (Mathias Blandeau, Thierry-Marie Guerra, Philippe Pudlo, François Gabrielli, Victor Estrada-Manzo)
– Filtrage H1des systèmes non linéaires à retard dans un domaine fréquentiel fini (Doha El Hellani, Ahmed El Hajjaji, Roger Ceschi)
– D-stabilisation locale des modèles T-S incertains via des fonctions de Lyapunov non quadratiques (Abdelmadjid Cherifi, Kevin Guelton, Laurent Arcese)
– Commande robuste par retour de sortie statique des modèles flous incertains : approche descripteur (Amel Ferjani, Ahmed El Hajjaji, Mohamed Chaabane)
COMPARAISONS
– Sommes-nous arithmétiquement flous ? (Sébastien Lefort, Marie-Jeanne Lesot, Elisabetta Zibetti, Charles Tijus, Marcin Detyniecki)
– Extensions floues de structures conceptuelles de comparaison (Didier Dubois, Henri Prade, Agnès Rico)
– Quel est le degré de concordance entre un point et un intervalle ? (Olivier Strauss, Inés Couso, Julien Pérolat)
– Comparaison de transformations probabilité-possibilité aux moyens de mesures de dissemblance dans un contexte de détection de changements (Charles Lesniewska-Choquet, Gilles Mauris, Abdourrahmane Atto)
INDEX DES AUTEURS
Livres de l'auteur Collectif LFA