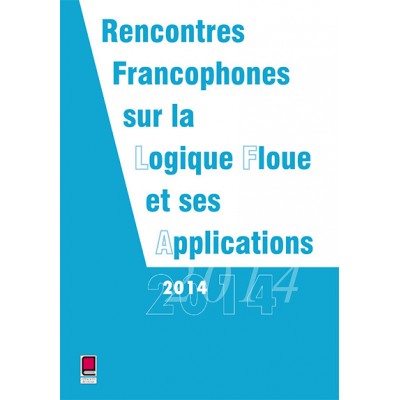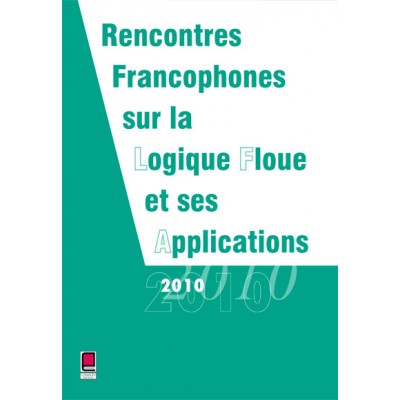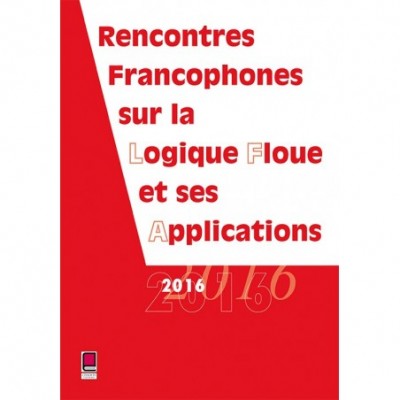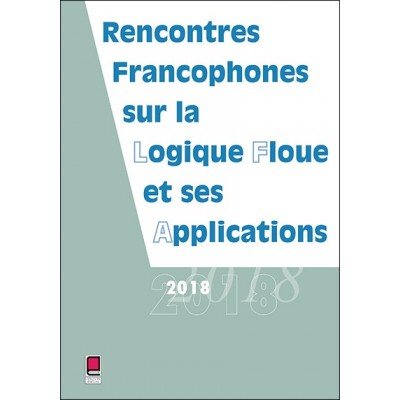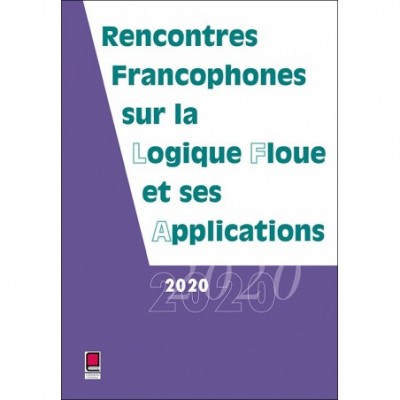Nahla Ben Amor
En tant que contributeur :
- Référence : 1156
- Année de parution : 2014
- Nombre de pages : 284
- Format : 17x24
- Reliure : Broché
Les conférences LFA offrent, chaque année, un lieu privilégié d'échanges où universitaires et industriels...
- Référence : 952
- Année de parution : 2010
- Niveau : Spécialistes
- Nombre de pages : 288
- Format : 17x24
- Reliure : Broché
- Référence : 1565
- Année de parution : 2016
- Nombre de pages : 296
- Format : 17x24
- Reliure : Broché
- Référence : 1677
- Année de parution : 2018
- Nombre de pages : 300
- Format : 17x24
- Reliure : Broché
- Référence : 1866
- Année de parution : 2020
- Nombre de pages : 208
- Format : 17x24
- Reliure : Broché