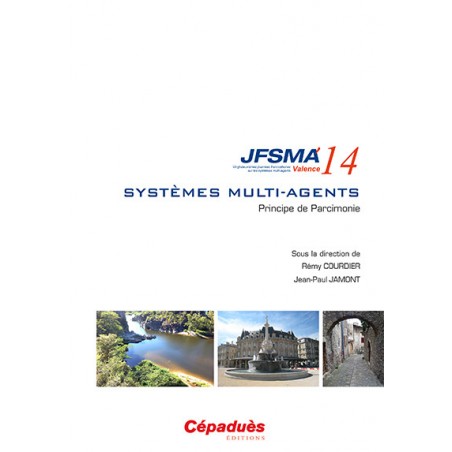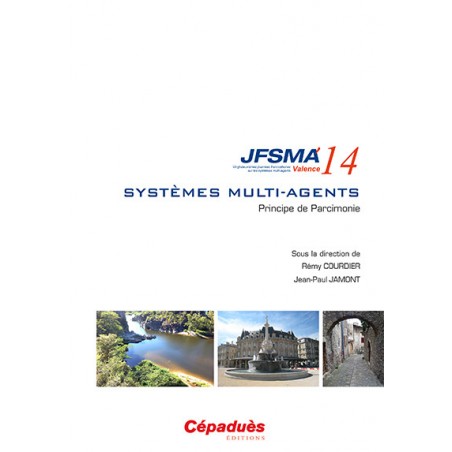Les Systèmes Multi-Agents ont pris maintenant leur place parmi les solutions applicatives reconnues par les concepteurs de systèmes au sein desquels des entités autonomes appelées agents coopèrent à la réalisation de tâches au travers d’une grande variété d’interactions et, bien souvent, l’existence de phénomènes collectifs qui font apparaître des propriétés émergentes à des niveaux divers.
Ce domaine de recherche qui mobilise des scientifiques issus majoritairement de l’informatique, des sciences cognitives et des systèmes complexes a produit un large spectre de solutions en terme de modèles, de solutions d’architectures, de méthodologies et de technologies que les développeurs d’applications diverses s’approprient de plus en plus et font évoluer selon leurs besoins.
La pluridisciplinarité de ce domaine en fait sa richesse et lui permet d’ouvrir de nouveaux chemins pour résoudre des problèmes qui peuvent s’avérer difficiles à appréhender par d’autres paradigmes. Cependant, on notera qu’au fil des années les propositions ont tendance à se sophistiquer, se complexifier, une façon d’avancer pour notre domaine est peut-être de s’intéresser au principe de parcimonie appelé jadis rasoir d’Ockam. Il s’agirait d’étudier la façon de l’appliquer à nos propositions en étudiant les voies nous permettant de ne pas multiplier les entités plus que nécessaire, à privilégier les modèles qui font appel au nombre d’hypothèses le plus faible, et à aussi peu de concepts que possible, ces concepts se devant en contrepartie d’offrir un champ d’application étendu.
Cette édition des JFSMA met donc en avant le principe de parcimonie dans les contributions scientifiques du domaine des Systèmes Multi-Agents. Ce principe est déjà fortement partagé dans la communauté et, en le portant en avant ainsi qu’en partageant ces résultats de recherche au travers de cet ouvrage, nous espérons contribuer à l’émergence des modèles computationnels de référence. Ceux-ci sont de plus en plus nécessaires à cette discipline de l’intelligence artificielle distribuée, son niveau de maturité nous permettant de nous atteler à ce difficile défi.
Le présent ouvrage rassemble les 19 contributions sélectionnées et présentées lors des vingt-deuxièmes éditions des JFSMA’14 qui se sont tenues à Loriol-sur-Drôme à proximité de Valence (FR) du 8 au 10 octobre 2014. Il réunit des articles couvrant un large champ d’applications traditionnelles de la thématique visant à répondre à différents problèmes que l’on peut décliner selon quatre aspects :
- le développement de systèmes informatiques décentralisés où l’approche SMA permet l’intégration flexible et la coopération de logiciels et de services autonomes,
- la résolution collective de problèmes au travers d’architectures d’agents distribuées,
- la simulation de phénomènes complexes où la modélisation multi-agent apporte un cadre conceptuel permettant la représentation et la simulation de systèmes faisant intervenir différentes entités en interaction,
- le développement de systèmes médiatisés où utilisateurs humains et agents artificiels interagissent directement ou indirectement, dans le cadre d’activités collectives de type éducatif, culturel ou social.