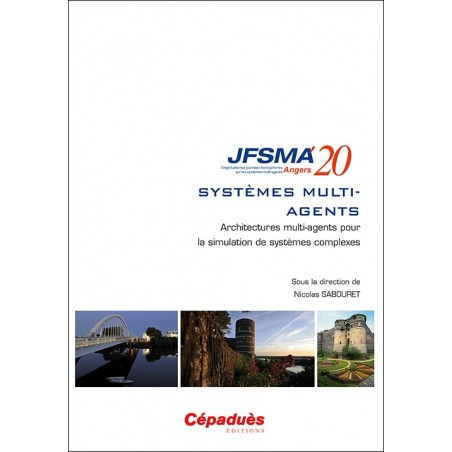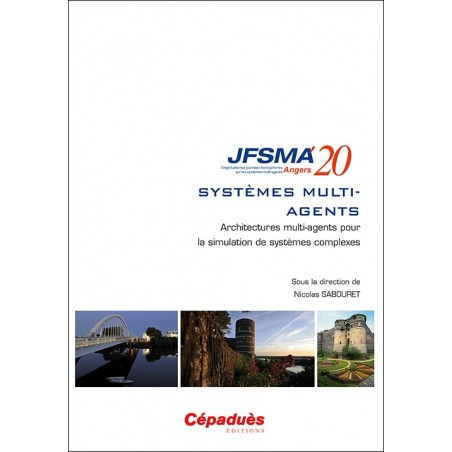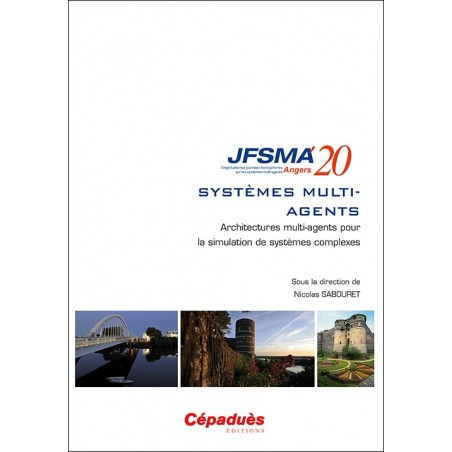Les Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents (JFSMA) sont un moment privilégié d’échanges scientifiques transversaux. Chaque année, elles réunissent des chercheurs qui étudient, utilisent et font évoluer le paradigme multi-agent pour adresser des problématiques issues de domaines liés à l’informatique (intelligence et vie artificielle, génie logiciel, robotique collective, etc.), à l’automatique et aux sciences humaines et naturelles (économie, sociologie, éthologie, etc.).
Cet ouvrage rassemble les 14 articles de l’édition 2020 des JFSMA, portant sur des sujets variés dans le domaine des Systèmes Multi-Agents : la simulation, la décision distribuée, l’habitat intelligent, la synchronisation, l’optimisation distribuée, l’émergence et les agents virtuels.
Précédentes éditions des JFSMA : Toulouse (1993), Grenoble (1994), Chambéry (1995), Port-Camargue (1996), Nice (1997), Nancy (1998), L’Île de la Réunion (1999), Saint-Étienne (2000), Montréal (2001), Lille (2002), Hammamet (2003), Paris (2004), Calais (2005), Annecy (2006), Carcassonne (2007), Brest (2008), Lyon (2009), Mahdia (2010), Valenciennes (2011), Honfleur (2012), Lille (plateforme IA, 2013), Valence (2014), Rennes (2015), Rouen (2016), Caen (2017), Métabief (2018), Toulouse (2019).
| Référence : |
1853 |
| Nombre de pages : |
162 |
| Format : |
17x24 |
| Reliure : |
Broché |