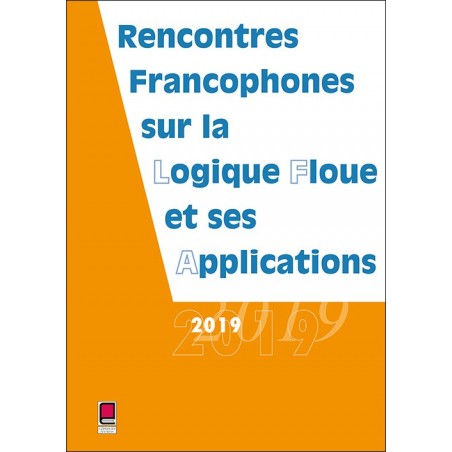



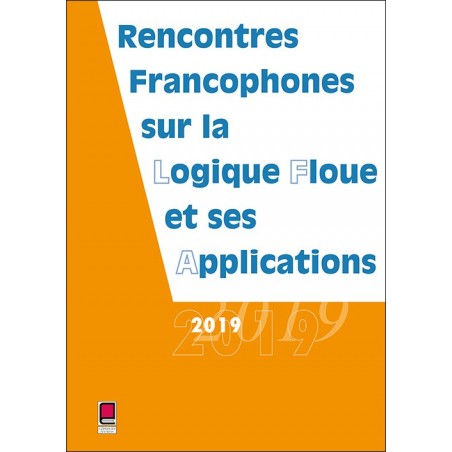

Les Rencontres Francophones sur la Logique Floue et ses Applications (LFA) constituent la manifestation scientifique annuelle où chercheurs et industriels se réunissent afin de faire le point sur les développements récents des théories de l’imprécis et de l’incertain. Celles-ci comprennent, par exemple, les sous-ensembles flous, les possibilités, les fonctions de croyance, les probabilités imprécises, les ensembles approximatifs et aléatoires ou des logiques non classiques. Le large éventail de domaines couverts va de la commande floue, domaine historique de l’application des sous-ensembles flous, à l’apprentissage automatique en passant par l’aide à la décision, le raisonnement, la fusion d’informations ou encore les bases de données, pour n’en citer que quelques-uns.

Commande avant 16h,
expédié le jour même (lu. - ve.)

Livraison express sous 48h.
Les Rencontres Francophones sur la Logique Floue et ses Applications (LFA) constituent la manifestation scientifique annuelle où chercheurs et industriels se réunissent afin de faire le point sur les développements récents des théories de l’imprécis et de l’incertain. Celles-ci comprennent, par exemple, les sous-ensembles flous, les possibilités, les fonctions de croyance, les probabilités imprécises, les ensembles approximatifs et aléatoires ou des logiques non classiques. Le large éventail de domaines couverts va de la commande floue, domaine historique de l’application des sous-ensembles flous, à l’apprentissage automatique en passant par l’aide à la décision, le raisonnement, la fusion d’informations ou encore les bases de données, pour n’en citer que quelques-uns.
Pour cette 28e édition, vingt-huit articles ont été retenus pour être inclus dans les actes, couvrant les thématiques classiques et émergentes telles que la commande floue, l’agrégation et la fusion d’informations, l’apprentissage automatique et la fouille de données, les bases de données, l’aide à la décision ou l’arithmétique floue.
À ce programme s'ajoutaient 3 conférences invitées :
- la première proposée par Leila Amgoud, directrice de recherche à l’IRIT à l’Université Paul-Sabatier de Toulouse. Ses travaux se situent dans le domaine de l’argumentation et de ses fondations, et son exposé portait sur cette dernière et sur ses liens possibles avec les théories de l’imprécis et de l’incertain.
- la deuxième proposée par Sylvie Le Hegarat-Mascle, professeur à l’Université de Paris Sud, au laboratoire SATIE. Ses travaux se concentrent notamment sur le développement d’outils propres à la théorie des fonctions de croyances, et leurs applications à des problématiques de traitement du signal.
- enfin, la troisième proposée par Olivier Strauss, Maître de conférences HDR à l’Université Montpellier II, au LIRMM. Ses travaux portent principalement sur le développement de techniques de traitement de signal et d’image intégrant des composantes floues, capables de manipuler des données imprécises et incertaines.
| Référence : | 1736 |
| Nombre de pages : | 226 |
| Format : | 17x24 |
| Reliure : | Broché |
| Rôle | |
|---|---|
| Collectif LFA | Auteur |
CONFÉRENCES INVITÉES
– Méthodes d’évaluation des arguments (Leila Amgoud)
– Fonctions de croyance : de la théorie a la pratique (Sylvie Le Hegarat-Mascle)
– Imprécisions et incertitudes dans les signaux numériques (Olivier Strauss)
CONTRIBUTIONS
– Quantifier la variabilité de séries temporelles de données imprécises (Zied Ben Othmane, Amine Aït Younes, Cyril de Runz, Vincent Mercelot)
– Règles spatiales floues et SIG pour l’évaluation d’un risque : le cas des feux de forêt (Laurence Boudet, Jean-Philippe Poli, Louis-Pierre Bergé, Michel Rodriguez)
– Sur le concept d’Intervalle Graduel Epais (IGE) : son sens, son utilité et son arithmétique associée (Reda Boukezzoula, Luc Jaulin, Laurent Foulloy)
– Efficient Mobius Transformations and their applications to Dempster-Shafer Theory (Maxime Chaveroche, Franck Davoine and Véronique Cherfaoui)
– Formalisation possibiliste du dilemme volonté/capacite à faire (Pierre Couturier, Abdelhak Imoussaten, Jacky Montmain)
– Clustering prudent : une approche relationnelle par seuillage (Sébastien Destercke, Mylène Masson, Benjamin Quost)
– Ajustement bayésien des mesures de similarité entre utilisateurs pour améliorer les recommandations basées sur un filtrage collaboratif (Yu Du, Sylvie Ranwez, Nicolas Sutton-Charani, Vincent Ranwez)
– Trois usages des capacités qualitatives (Didier Dubois, Francis Faux, Henri Prade, Agnes Rico)
– Ensembles épais, fonctions multivoques, et théorie des possibilités (Didier Dubois, Luc Jaulin, Henri Prade)
– Système a base de règles floues pour la reconnaissance de composés chimiques (Edwin Friedmann, Jean-Philippe Poli)
– Degré chrysippien dans une structure d’operateurs de logique floue (Driss Gretete, Khalid El Aroui, Mbarek Zaoui)
– Sur le raffinement du skyline : Une approche utilisant le treillis des concepts formels flous (Mohamed Haddache, Allel Hadjali, Hamid Azzoune)
– Fusion multimodale pour la reconnaissance des espèces d’arbres à partir des feuilles et des écorces (Siwar Jendoubi, Didier Coquin, Reda Boukezzoula)
– Proposition d’une approche mixte floue et neuro-floue pour le contrôle d’un système sous actionne et couple (Larbi Kharroubi, Hichem Maaref, Wahid Nouibat)
– Transformation possibiliste de lois de probabilités multi-variées elliptiques (Charles Lesniewska-Choquet, Gilles Mauris, Abdourrahmane Atto)
– Génération efficace d’estimations fiables de résumés linguistiques (Marie-Jeanne Lesot, Grégory Smits, Pierre Nerzic, Olivier Pivert)
– Possibilistic Hierarchical Clustering ( Helmi Manai, Zied Elouedi)
– Entropies et ensembles flous intuitionnistes (Christophe Marsala, Bernadette Bouchon-Meunier)
– Une nouvelle méthode normalisée pour la reconnaissance supervisée et la localisation d’objets basée sur la forme (Behrang Moradi Koutchi, Baptiste Magnier)
– Apprentissage de corrections contextuelles crédibilistes à partir de données partiellement étiquetées en utilisant la fonction de contour (Siti Mutmainah, Frédéric Pichon, David Mercier)
– Modélisation incertaine à partir de mesures non-reproductibles. Application a la comparaison de pression exercée par des matelas (Cyprien Neverov, Chihab Khnifass, Papa Beye, Nicolas Sutton-Charani, Abdelhak Imoussaten,Willy Fagart, Mylène Blot, Arnaud Dupeyron)
– Entropies et ensembles flous intuitionnistes (Dickson Owuor, Anne Laurent, Joseph Orero)
– Partitionnement de séries temporelles par modèles de mélange avec contraintes sur les instants d’amorçage des clusters (Emmanuel Ramasso, Thierry Denoeux)
– Etude d’un opérateur d’agrégation a la baisse en logique multivalente (Adrien Revault d’Allonnes, Marie-Jeanne Lesot)
– Une extension signée de la transformation floue imprécise (Olivier Strauss, Agnès Rico)
– Correction bayésienne de prédictions issues d’arbres de décision et évaluation crédibilise (Nicolas Sutton-Charani)
– Système d’Aide a la Décision a base de Logique Floue : Application a l’Agriculture Intelligente (Ahmad Tay, Frédéric Lafont, Jean-François Balmat, Nathalie Pessel)
– Un modèle Belief-Constrained Programming pour le VRPTW avec temps de service et de trajet crédibilistes (Tekwa Tedjini, Sohaib Afifi, Frédéric Pichon, Eric Lefèvre)
Livres de l'auteur Collectif LFA