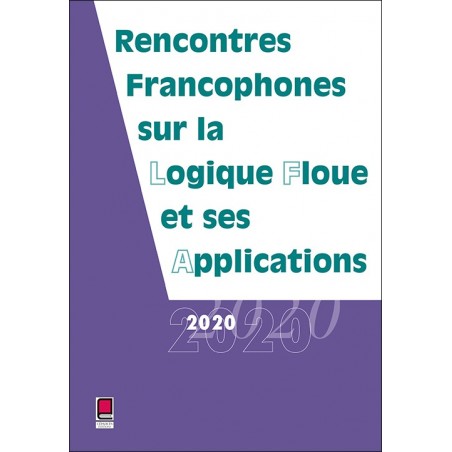



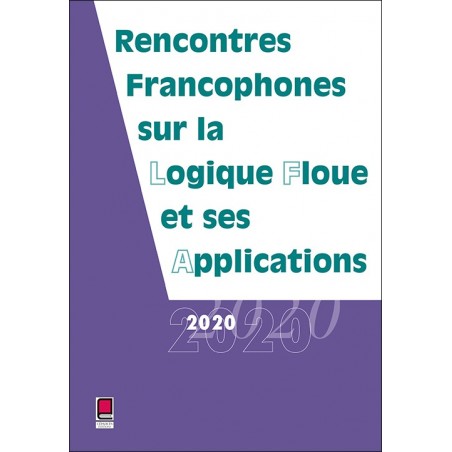


Commande avant 16h,
expédié le jour même (lu. - ve.)

Livraison express sous 48h.
Les Rencontres Francophones sur la Logique Floue et ses Applications (LFA) constituent la manifestation scientifique annuelle où chercheurs et industriels se réunissent afin de faire le point sur les développements récents des théories de l’imprécis et de l’incertain. Celles-ci comprennent, par exemple, les sous-ensembles flous, les possibilités, les fonctions de croyance, les probabilités imprécises, les ensembles approximatifs et aléatoires ou des logiques non classiques. Le large éventail de domaines couverts va de la commande floue, domaine historique de l’application des sous-ensembles flous, à l’apprentissage automatique en passant par l’aide à la décision, le raisonnement, la fusion d’informations ou encore les bases de données, pour n’en citer que quelques-uns.
En complément des 22 articles retenus, une conférencière invitée et deux conférenciers invités retracent les principales avancées et exposent les enjeux actuels de trois domaines de recherche où la gestion des imprécisions et des incertitudes est cruciale : l'extraction de connaissances, l'aide à la décision et le contrôle automatique.
La première conférence est donnée par Bernadette Bouchon-Meunier, directrice de recherche émérite au Laboratoire Informatique de Paris, Sorbonne Université, et concerne l'apport de la théorie des sous-ensembles flous pour l'explicabilité des méthodes d'intelligence artificielle.
La deuxième conférence, proposée par Jérôme Lang, directeur de recherche CNRS-Université Paris-Dauphine, porte sur la prise de décision collective.
Enfin il nous a semblé important de redorer le blason de la thématique qui a fait connaître le flou au grand public, à savoir la commande floue. Kévin Guelton, professeur à l’université de Reims, nous en présentera les dernières avancées.
| Référence : | 1866 |
| Nombre de pages : | 208 |
| Format : | 17x24 |
| Reliure : | Broché |
| Rôle | |
|---|---|
| Collectif LFA | Auteur |
Preface
Comités
CONFÉRENCES INVITÉES
– La contribution du flou à l’explicabilite de l’intelligence artificielle Bernadette Bouchon-Meunier
– Du flou dans les décisions collectives Jérôme Lang
– Modèles flous de type Takagi-Sugeno : des origines à la problématique actuelle de leur commande à base de signaux échantillonnés Kévin Guelton
FOUILLE DE DONNÉES ET BASES DE DONNÉES
– Caractérisation d’exceptions dans les résumés flous extraits de graphes de propriétés Arnaud Castelltort, Anne Laurent
– Croisements de données de l’Internet des Objets pour l’extraction de motifs graduels temporels flous Dickson Owuor, Anne Laurent, Joseph Onderi Orero
– Explication linguistique des propriétés structurelles de données régulières et irrégulières Amit Shukla, Grégory Smits, Marie-Jeanne Lesot, Olivier Pivert
– Modélisation de concepts par intégrales de Choquet Grégory Smits, Ron Yager, Marie-Jeanne Lesot, Olivier Pivert
TRAITEMENT D’IMAGES
– On linguistic descriptions of image content Isabelle Bloch
– Transfert de couleur : vers une approche intervalliste Olivier Strauss, William Puech
THÉORIE DES POSSIBILITÉS
– Ordinal Polymatrix Games with Incomplete Information Nahla Ben Amor, Hélène Fargier, Régis Sabbadin, Meriem Trabelsi
– Approches logiques ou ensemblistes de la classification Didier Dubois, Henri Prade
– Construction de distributions de possibilité bivariées à partir de distributions marginales connues Charles Lesniewska, Gilles Mauris, Abdourrahmane Atto
OPTIMISATION, COMPLEXITÉ
– Apprentissage de rangements prudent avec satisfaction de contraintes Yonatan Carlos Carranza Alarcon, Soundouss Messoudi, Sébastien Destercke
– Stability Analysis of TS Systems via Reduced-Complexity Affine Representation Amine Dehak, Anh-Tu Nguyen, Antoine Dequidt, Laurent Vermeiren, Michel Dambrine
PRÉFÉRENCES ET MODÉLISATION DE CONNAISSANCES
– Inferer a partir d’un modele de Plackett-Luce imprecis : application au rangement d’etiquettes Loïc Adam, Arthur Van Camp, Sébastien Destercke, Benjamin Quost
– Le tesseract de l’intégrale de Sugeno Didier Dubois, Henri Prade, Agnès Rico
– Elections équitables envers des communautés de votants Jérôme Lang, Agnès Rico
– Interprétabilité des entropies d’ensembles flous intuitionnistes ou définis par intervalles Christophe Marsala and Bernadette Bouchon-Meunier
– Formalisation du concept d’assortiment idéal dans la grande distribution Jocelyn Poncelet, Pierre-Antoine Jean, Michel Vasquez, Jacky Montmain
APPRENTISSAGE, CLASSIFICATION
– Imputation credibiliste pour la prediction de charge interne de joueurs de football Rayane Elimam, Nicolas Sutton-Charani, Jacky Montmain, Stéphane Perrey
– Subspace clustering et typicite d’attributs : une étude prospective Marie-Jeanne Lesot, Adrien Revault d’Allonnes
– Operateurs de Derivation Modaux pour l’Analyse Logique de Concepts Mohammed Sadou, Yassine Djouadi, Hadjali Allel
FONCTIONS DE CROYANCE
– Traitement du problème d’optimisation de mélange dans le cas de données incertaines via les fonctions de croyance Lucie Jacquin, Abdelhak Imoussaten, Sébastien Destercke
– Traitement évidentiel d’exemples atypiques Marie-Helene Masson, Benjamin Quost, Sébastien Destercke
– Toward a generalization of belief functions approximation Tekwa Tedjini, Sohaib Afifi, Frédéric Pichon, Eric Lefevre
INDEX DES AUTEURS
Livres de l'auteur Collectif LFA