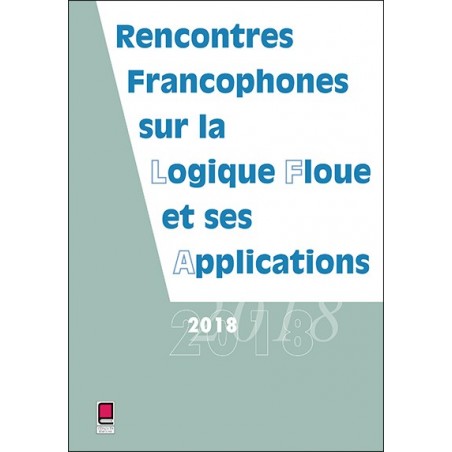



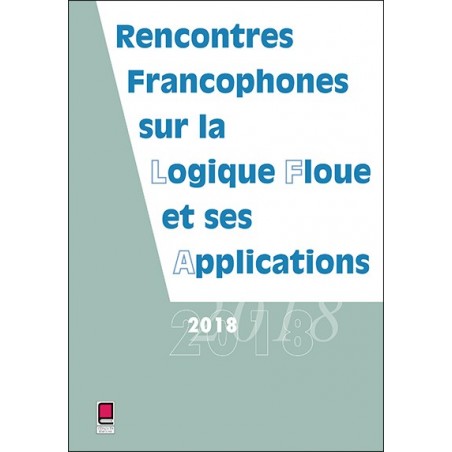


Commande avant 16h,
expédié le jour même (lu. - ve.)

Livraison express sous 48h.
Les Rencontres Francophones sur la Logique Floue et ses Applications (LFA) constituent la manifestation scientifique annuelle où les chercheurs et industriels se réunissent afin de faire le point sur les développements récents des théories de l’imprécis et de l’incertain. Celles-ci comprennent par exemple les sous-ensembles flous, les possibilités, les fonctions de croyance, les probabilités imprécises, les ensembles approximatifs et aléatoires ou des logiques non classiques. Le large éventail de domaines couverts va de la commande floue, domaine historique de l'application des ensembles flous, à l'apprentissage automatique en passant par l'aide à la décision, le raisonnement, la fusion d'informations ou encore les bases de données, pour en citer quelques-uns.
Pour cette 27e édition, 33 articles, qui témoignent de cette diversité, à la fois des points de vue théorique et applicatif, ont été retenus. Ce programme est complété par 3 conférences invitées :
- la première donnée par Luc Jaulin, Professeur à l'Université de Bretagne Occidentale et Chercheur au laboratoire Lab- STICC ENSTA-Bretagne, sur la caractérisation d’une zone explorée par un robot sous-marin.
- la seconde donnée par le Docteur Matthias Troffaes, Chercheur au Department of Mathematical Sciences, Durham University, UK, sur une méthodologie de représentation et de quantification de l'incertitude, basée sur un concept comportemental appelé : la désirabilité.
- La troisième donnée par Véronique Cherfaoui, Professeure à l'Université de Technologie de Compiègne et Chercheuse au laboratoire Heudiasyc, sur une problématique de fusion multi-sources hétérogènes pour les véhicules intelligents.
| Référence : | 1677 |
| Nombre de pages : | 300 |
| Format : | 17x24 |
| Reliure : | Broché |
| Rôle | |
|---|---|
| Collectif LFA | Auteur |
CONFÉRENCES INVITÉES
– Caractérisation d’une zone explorée par un robot sous-marin (Luc Jaulin)
– A Behavioural Approach To Modelling Severe Uncertainty & An Application to Quantify Impact Of Renewable Energy Integration (Matthias C. M. Troffaes)
– Perception dynamique des véhicules autonomes : modélisation de l’incertitude dans des grilles d’occupation (Véronique Cherfaoui)
BASES DE DONNÉES ET REPRÉSENTATION DE L’INFORMATION
– Modèles possibilistes de bases de données relationnelles incertaines - Une vue d’ensemble (Olivier Pivert, Henri Prade)
– Génération efficace de résumés linguistiques estimés (Grégory Smits, Pierre Nerzic, Olivier Pivert, Marie-Jeanne Lesot)
– Représentation visuelle d’informations par des émoticônes colorées (Laurent Foulloy, Lamia Berrah, Vincent Clivillé)
– OSACA : Découverte d’attributs symboliques ordinaux (Christophe Marsala, Anne Laurent, Marie-Jeanne Lesot, Maria Rifqi, Arnaud Castelltort)
APPRENTISSAGE, CLUSTERING ET CLASSIFICATION
– K-nearest neighbors classifier under possibility framework (Sarra Saied, Zied Elouedi)
– K-NN crédibiliste pour la reconnaissance automatique des espèces d’arbres (Siwar Jendoubi, Didier Coquin, Reda Boukezzoula)
– Régularisation laplacienne pour le subspace clustering (Arthur Guillon, Marie-Jeanne Lesot, Christophe Marsala)
– Mesurer la dissimilarité au niveau d’une partition floue (Grégory Smits, Olivier Pivert, Toan Ngoc Duong)
– Analyse Discriminante Imprécise basée sur l’inference Bayésienne robuste (Yonatan-Carlos Carranza-Alarcon, Sébastien Destercke)
– Étalonnage évidentiel actif de classifieurs SVM (Sébastien Ramel, Frédéric Pichon, Francois Delmotte)
– Apprentissage partiellement supervisé dans les modèles de Markov cachés autoregressifs pour le monitoring et le pronostic de systèmes et structures mécaniques (Emmanuel Ramasso, Vincent Placet)
FONCTIONS DE CROYANCE
– Une famille de mesures de conflit entre fonctions de croyance (Nadia Ben Abdallah, Anne-Laure Jousselme, Frédéric Pichon)
– Capacités qualitatives séparables (Didier Dubois, Francis Faux , Henri Prade, Agnès Rico)
– Modélisation du profil des contributeurs dans les plateformes de crowdsourcing (Constance Thierry, Jean-Christophe Dubois, Yolande le Gall, Arnaud Martin)
– Détection des faux avis dans un cadre évidentiel (Malika Ben Khalifa, Zied Elouedi, Eric Lefèvre)
COMMANDE
– De l’implémentation des contrôleurs Takagi-Sugeno avancés : application au contrôle du papillon d’un moteur essence (Thomas Laurain, Jimmy Lauber, Reinaldo Palhares)
– Commande tolérante aux défauts actionneurs des systèmes flous descripteurs à retard (Dhouha Kharrat, Hamdi Gassara, Ahmed El Hajjaji, Mohamed Chaabane)
– Robust Fuzzy Predictive Control of DC-DC Buck-Boost Converter (Sofiane Bououden, Mohammed Chadli, Ilyes Boulkaibet)
– Une méthode de réduction du nombre de sommets pour les modèles Takagi-Sugeno : exemple dans le domaine mécanique (Thierry-Marie Guerra, Mathias Blandeau, Miguel Bernal)
– Synthèse H_/H1 d’un observateur PI pour la détection de défauts des systèmes T-S incertains (Salama Makni, Maha Bouattour, Ahmed El Hajjaji, Mohamed Chaabane)
– Synthèse LMI pour la commande d’un robot manipulateur à 2 ddl par l’approche descripteur TS (Thi Van Anh Nguyen, Anh Tu Nguyen, Laurent Vermeiren, Antoine Dequidt, Michel Dambrine, Cung Le)
– Contrôle H1des systèmes non linéaires de type TS dans un domaine fréquentiel fini (Doha El Hellani, Ahmed El Hajjaji, Jérôme Bosche)
REPRÉSENTATIONS POSSIBILISTES
– Approximations linéaires par morceaux de distributions de possibilités issues de transformations de loi de probabilité (Laurent Foulloy, Gilles Mauris)
– Les Jeux Hypergraphiques Ordinaux (Arij Azzabi, Nahla Ben Amor, Hélène Fargier, Régis Sabbadin)
– Jeux possibilistes à information incomplète (Nahla Ben Amor, Hélène Fargier, Régis Sabbadin, Meriem Trabelsi)
OUTILS D’EXTENSION INCERTAINE
– Extensions de la préférence statistique aux variables aléatoires floues (Farid Aiche)
– Opérateurs Min et Max pour intervalles graduels (Reda Boukezzoula, Sylvie Galichet, Laurent Foulloy)
– Extension signée de la domination des noyaux maxitifs (Olivier Strauss, Agnès Rico)
– Fuzzy one-way ANOVA using the signed distance method to approximate the fuzzy product (Rédina Berkachy, Laurent Donzé)
RAISONNEMENT ET DÉCISION DANS L’INCERTAIN
– Représentation de la c-révision à base de la logique des pénaliés (Safia Laaziz, Younes Zeboudj, Salem Benferhat, H.F. Khellaf)
– Commutation des intégrales de Sugeno (Didier Dubois, Hélène Fargier, Agnès Rico)
– Inférences prudentes dans des grilles d’occupation : planification de trajectoires de véhicules dans l’incertain (Sébastien Destercke, Véronique Cherfaoui, Mylène Masson, Hafida Mouhagir, Sarah Fakih)
– Identification de l’Information Pertinente pour la Prise de Décision : Application à la Logistique Humanitaire (Cécile L’Héritier, Abdelhak Imoussaten, Sébastien Harispe, Gilles Dusserre, Benoit Roig)
INDEX DES AUTEURS
Livres de l'auteur Collectif LFA